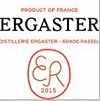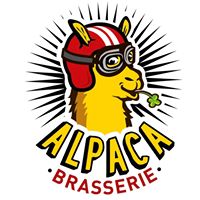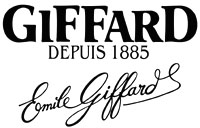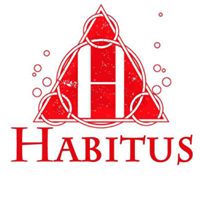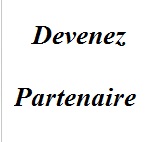Les métiers
Divers métiers qui ont un rapport avec la boissons : fabrication, élaboration, consommation.
|
Bouilleur de cru (Distillateur) |
Barman
L'employé de bar, ou, masculin barman, féminin barmaid, prépare et effectue le service des boissons chaudes, froides,
simples ou composées (cocktails).
Le Flair Bartending ou jonglerie de bar :
Le flair bartending est une discipline acrobatique pratiquée par
certains barmen appelés « flair bartenders ». Cela
consiste à jongler avec des bouteilles, des shakers, des verres
ou autres accessoires de bar, afin de faire des cocktails. Ce sport connaît
ses heures de gloire depuis 1988, suite au film COCKTAIL avec Tom Cruise.
Dans les années 2000, des bouteilles incassables facilitant l’entraînement
sont vendues par les marchands de matériel de jonglerie.
Fédération française de flair bartending : http://www.fffb.fr/
Brasseur / Brasseuse de bière
Personne qui fabrique de la bière.
C'est un métier aussi vieux que le peuple Français, remontant à
l’Antiquité (la bière appelée « sikaru » est attestée à
Sumer au IVe millénaire av. J.-C.), la fabrication de la bière se fait grâce
au savoir-faire des brasseurs domestiques et exclusivement à partir d’éléments naturel.
Les Gaulois, au IVème siècle avant JC, considéraient la bière
ou cervoise comme leur boisson nationale.
Les moines ont reçu le privilége de brassage sous Charlemagne, et ont conservé ce monopole jusque sous Louis XIV.
A Paris, des statuts furent donnés
aux cervoisiers, vers 1268, par le premier garde
de la prévôté de Paris,
Étienne Boileau.
A la fin du quinzième siècle,
en 1489, ces statuts furent confirmés
et reçurent un plus grand développement.
La communauté prit le nom de «
communauté des cervoisiers et faiseurs
de bière ». Une des clauses les
plus importantes de ces statuts de 1489 fut
sans contredit celle qui obligeait les brasseurs
à marquer leurs barils.
De nouveaux statuts furent rédigés ou confirmés en 1514, en 1630, en 1687 ; ces statuts firent défense expresse de brasser le dimanche, les jours de fêtes solennelles et de fêtes Notre-Dame.
L’organisation de la corporation des brasseurs, à la fin du dix-huitième siècle, était dirigée par trois jurés ou gardes, dont deux se changeaient de deux en deux ans. L’apprentissage durait cinq années, et en outre, avant de passer maître, il fallait être trois ans compagnon et faire ensuite un chef-d’œuvre. Chaque maître ne pouvait avoir qu’un seul apprenti ; s’il en avait deux, l’un devait commencer sa première année quand l’autre entrait dans sa cinquième. Les fils de maître avaient le privilège d’ouvrir boutique en faisant simplement le chef-d’œuvre en présence des jurés, privilège qui leur donnait ainsi huit ans d’avance sur les confrères.
Suite à la révolution Française, le métier est libre.
On trouve aussi le terme de brasserie artisanale, mais il faut pour cela en France que le brasseur ait le statut d’artisan (lois de 1996), ce qui n’est pas nécessairement le cas.
La liste des brasseurs en France
Caviste
La vente dans une cave de vins ou d'autres boissons, avec ou sans alcool.
Il pratique des analyses sommaires et suit le vin en fonction de sa destination
: vente en vrac ou mise en bouteilles.
Le métier de caviste est avant tout un métier de conseil.
Au delà, de ces connaissances générales, le Caviste
doit parfaitement connaître ses produits.
Le métier de caviste, une profession qui fût réglementée dès le Moyen-âge en France.
Malgré la création de caves, le métier
de caviste n’existe pas encore. Mais, il existe en revanche différents
types de marchands de vin.
Il y a les marchands de vin en gros vendent des pièces de vin, c’est-à-dire
en tonneau, en barrique. Et il y a les détaillants, qu’il s’agisse
de marchands spécialisés, de taverniers ou de cabaretiers
ne peuvent vendre le vin qu’« à pot » ou «
à pinte », à leur comptoir.
En 1587, le roi Henri III décide de règlementer la vente de vin.
En 1628, la vente de bouteilles de Champagne est autorisée.
En 1672, une ordonnance du roi interdit la vente en bouteille et préconise la vente en pots et pintes en étain. Le roi justifie cette interdiction par la difficulté d’étalonner la contenance des bouteilles.
En 1822, Louis Nicolas créé la Maison Nicolas, qui propose pour la première fois la vente aux particuliers de vins en bouteille et devient de fait, le premier caviste contemporain.
En 1998, un programme de formation avec diplôme de Caviste Professionnel à la clef est mis en place à l’école hôtelière de Vannes. La première promotion sort en 2000.Cidrier / Cidrière
La fabrication du cidre.
Le cidre aurait déjà été consommé dès
l'Antiquité par plusieurs peuples.
La première mention de
cidre en Normandie remonte à l’an
1082.
Le cidre était la boisson du peuple dans le Maine : il est mentionné à Laval en 1434.
Au xixe siècle, le cidreétait la deuxième boisson la plus consommée en France.
Distillateur
Personne qui produit de l'alcool, grâce à un alambic.
Celui qui fabrique et vend des produits obtenus par distillation et plus particulièrement
des eaux de vie et des liqueurs.
Un vieux métier, le distillateur, le distillateur ambulant, ou, bouilleur de cru.
Après avoir été longtemps confiné entre les murs des monastères, l’usage de la distillation commence à se répandre.
En France, la distillation existe
déjà au XVIème siècle.
L'Armagnac est une ancienne eau-de-vie de France
: le premier témoignage de son utilisation
remonte à l'an 1310, quand Maître
Vital Dufour, Prieur d'Eauze et de Saint Mont,
vantait en latin les 40 vertus de cette Aygue
Ardente dans son livre « Pour garder la
Santé et rester en bonne forme ».
Avant la mise en place de taxe, tout le monde pouvait distiller en France.
Distiller de l’alcool est un privilège
instauré par Napoléon.
Au début du XIXe siècle, l’Empereur
accordait l’exonération de taxes pour la distillation
de 10 litres d’alcool pur ou 20 litres
d’alcool à 50 % .
Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir ce
privilège pour pouvoir distiller. La seule différence
concerne la taxe. Ceux qui ne bénéficient pas
du privilège napoléonien paient la taxe sur
toute la production.
Ce privilège qui restera héréditaire jusqu’en 1960.
Par la suite, le législateur interdira la transmission
entre génération, seul le conjoint survivant
pourra bénéficier de ce droit jusqu’à sa mort.
Le droit de distiller fut d’abord accordé aux propriétaires exploitants. Cependant, tous les agriculteurs n’étant pas équipés d’un alambic, une nouvelle profession : distillateur ambulant, vit le jour. Il s’installait de village en village afin de transformer la partie des fruits ou de la vendange passée au fouloir et mise à fermenter. Son alambic devait être enregistré auprès des douanes et droits indirects.
Le sujet de la distillation de l’alcool en France est très sensible. Plusieurs projets de suppression du privilège de détaxation des premiers litres d’alcool n’ont pas abouti, ou ont été reportés à maintes reprises.
À partir des années 1900, la question des bouilleurs de cru a fait éclore pléthore de règlements et de circulaires, à tel point qu’on en était arrivé au cours des années 1930 à ce que plus personne ne soit à même de comprendre où se situaient les obligations et les interdictions.
En 1941, le gouvernement de Vichy interdit
la distillation à domicile, droit rétabli en
faveur des agriculteurs en 1953.
Les années 1990 vont voir, une fois de
plus, se multiplier les propositions de lois
sur la distillation de l’alcool générant un
véritable combat politique entre les élus, la
ligue antialcoolique et les représentants des
producteurs d’eau de vie.
En 2002, une loi de finances établit la suppression
de la franchise accordée aux bouilleurs de cru
encore titulaires de ce privilège.
Face aux multiples réactions contestataires,
une période de cinq ans prolongera ce droit
jusqu’au 31 décembre 2007.
À compter de la campagne de distillation 2008,
les anciens titulaires du privilège pouvaient
encore bénéficier d’une remise de 50 %
sur la taxe pour les 10 premiers litres
d’alcool pur.
Un nouvel amendement voté au Sénat a prorogé
le droit sur les 10 premiers litres jusqu’au
31 décembre 2010. « À l’heure
actuelle, nous sommes dans une vraie nébuleuse
de vapeur d’alcool ! » écrit un parlementaire.
Bouilleurs de cru et distillateurs ambulants sont réunis au sein d’une fédération, la FNSRPE. Le combat est permanent entre les distillateurs, les associations de lutte contre l’alcoolisme et les élus. Tout ceci, sous la pression des lobbies des grands importateurs ou fabricants d’alcool ayant du mal à accepter les distillateurs indépendants.
En 1959, on comptait 3 160 000 bouilleurs de cru en France (distillateurs ambulants et agriculteurs). Ils n’étaient déjà plus que 357 000 en 1996.La liste des distillateurs français
Graveur sur verre
C’est apparemmenten 1456, à Venise, que l’idée de graver des dessins sur le verre aurait vu le jour.
La technique la plus ancienne se nomme gravure directe et se pratique à l’aide d’une pointe diamant soit à la main.
Il est également possible de faire de la gravure avec de l’acide, c’est la morsure de l’acide qui va faire apparaître le décor.
Charles Gallé ouvre, en 1867, son propre atelier de gravure sur verre à Nancy.
Limonadier
Intégrée peu à peu par les Italiens au XVIIème siècle, la limonade fait partie des plus anciennes
boissons du commerce des boissons.
A cette époque, la corporation des limonadiers était en
minorité face aux vinaigriers et apothicaires qui souhaitaient
lui interdire la vente de certaines boissons.
Accablés par d’interminables et onéreux
procès, les limonadiers s’unirent alors aux distillateurs afin de lutter.
Sur la demande des limonadiers unis, Louis XIV érigea cette profession
en corps de métier.
C’est la Compagnie de Limonadiers, fondée en 1676, qui octroya
donc les droits de monopole sur la vente de ce produit et autorisa les
limonadiers et distillateurs à débiter des boissons rafraîchissantes
ainsi que des liqueurs fortes, à l’exception du vin réservé
aux cabaretiers.
Les statuts de cette corporation établirent que quatre gardes jurés
seraient élus pour deux ans par l’assemblée des maîtres
et visiteraient deux fois par an chaque boutique. Il ne devait y avoir
à Paris que deux cent cinquante maîtres. Une fois arrivé
à ce nombre, on ne ferait de maîtres nouveaux qu’à
mesure des extinctions. Pour devenir maître, il faudrait avoir été
apprenti pendant trois ans, après lesquels on était aspirant
ou compagnon, faire un chef-d’oeuvre et payer 20 livres, à
moins qu’on ne fût fils ou gendre de maître.
Une ordonnance de police de 1685, au sujet des limonadiers, mérite
d’être citée. « Les boutiques des limonadiers,
dit l’ordonnance, restent ouvertes pendant toute la nuit ; elles
servent maintenant de lieu d’assemblée et de retraite aux
voleurs de nuit, filous et autres gens malvivants et déréglés,
ce qui se fait avec d’autant plus de facilité que toutes
ces boutiques et maisons sont désignées et distinguées
des autres par des lanternes particulières sur la rue, qu’on
y allume tous les soirs et qui servent de signal. Ordonnons, en conséquence,
que les lanternes seront ôtées et les boutiques fermées
après cinq heures du soir de novembre en mars, et après
neuf heures de mars en octobre. »
Les limonadiers protestèrent, représentant que leur commerce
n’avait presque d’activité que le soir. Sur leurs réclamations,
on leur donna jusqu’à six heures en hiver et dix heures en
été.
On eut, en 1704, l’idée de les supprimer et de les remplacer
par des espèces de limonadiers en titre d’office, qui achèteraient
leur charge au roi, bien entendu, et la transmettraient par testament
ou par vente, ni plus ni moins que des notaires leurs notariats. Cent
cinquante privilèges de limonadiers furent créés,
et défense faite tout simplement aux anciens de tenir boutique.
Les limonadiers firent rétracter l’édit en offrant
au roi 200 000 livres. Ils devaient les payer en plusieurs fois. Pour
qu’ils pussent amasser cette somme, on modifia leurs statuts à
l’article concernant la réception des apprentis.
Les fils de maîtres durent payer la maîtrise 300 et 500 livres,
selon les cas ; les étrangers, 800 livres. Peu après, les
limonadiers trouvèrent leur obligation envers le trésor
royal trop lourde, et cherchèrent un prétexte à chicaner
leur contrat. Les épiciers, leurs anciens ennemis, ne devaient
vendre de l’eau-de-vie que par petits verres. Le client, chez eux,
devait consommer debout ; or, on continuait de boire assis chez les épiciers.
Les limonadiers protestaient qu’ils ne pouvaient pas achever de
payer les 200 000 livres promises tant qu’on n’aurait pas
détruit cet abus criant.
Le Conseil du roi répliqua en abolissant la communauté des
limonadiers et en créant cinq cents privilèges que les anciens
propriétaires de cafés eurent permission d’acheter.
Cet état de choses dura peu.
On revint, en 1713, aux anciens errements ; la communauté des limonadiers fut rétablie et subsista jusqu’à l’abolition des jurandes.
Édit de Turgot de 1776 supprimant les corporations.
En février 1776, Turgot, contrôleur général
des finances, obtint du roi Louis XVI la suppression des communautés
de métiers.
Le Parlement de Paris refusa de l’enregistrer et il fallut un lit
de justice, le 12 mars 1776, pour l’y contraindre.
Ces difficultés provoquèrent la disgrâce de Turgot
qui fut révoqué par le roi le 12 mai suivant.
L’édit du roi enregistré au Parlement le 23 août
1776 revient sur l’abolition des corporations, mais sans remettre
le droit en l’état antérieur.
Les six Corps de Marchands et les quarante-quatre Communautés de
Métiers que le nouvel édit recrée à Paris
obéissent à des règles nouvelles. En outre, il conserve
libres vingt-deux métiers ou commerces qui ne sont assujettis à
aucun règlement particulier, sauf une obligation de déclaration.
La mise en œuvre du nouvel édit dans tout le royaume n’était
pas achevée lorsque le décret d’Allarde supprima,
de manière définitive, les corporations en 1791.
Après la révolution Française, le travail de limonadier est souvant groupé avec celui de brasseur.
Oenologue
Etymologiquement, œnologue signifie “celui qui possède la science du vin”.
Le diplôme national d'œnologue est un titre protégé depuis la loi du 19 mars 1955.
Expert qualifié titulaire du diplôme national d'oenologue (niveau bac +5),
l’œnologue contribue à l’amélioration de la qualité des vins.
L'oenologue, grâce à ses connaissances scientifiques, juridiques et techniques, accompagne et supervise l’élaboration des vins et des produits dérivés du raisin. Sa principale activité concerne la vinification.
Il conseille les viticulteurs dans le choix
des cépages et la plantation des vignes.
Il surveille les fermentations en cave, le traitement
des vins et leur conditionnement.
Il effectue des analyses et procède à
des recherches technologiques visant à
l’amélioration des cépages.
Porteur d'eau
En 1715, on compte près de 600 porteurs d'eau à Paris.
25 mai 1703, ordonnance de police pour la discipline des porteurs d'eau qui puisent aux fontaines.
4 juin 1726 : sentence de police qui défend aux porteurs et porteuses d'eau d'empêcher les bourgeois de puiser avant eux.
Fin 1767, une machine pour clarifier l'eau de la Seine fut inventée
et en mai 1768, le rapport favorable du Lieutenant Général
de Police marqua la naissance d'une société de distribution
de l'eau clarifiée à raison de 2 sols 6 deniers la voie,
tenant 36 pintes rendue chez le particulier à quelque étage
que soient leur demeure ; dans les faubourgs, il en coute 6 deniers de
plus, sauf pour Saint Germain considéré comme intra-muros.
ce service est assuré sur abonnement. Les tonneaux sont peints
aux couleurs du Roi et de la Ville ; ils sont fermés d'un cadenas
et la clé est confiée à des préposés,
supervisé par un Inspecteur. Les charretiers et porteurs d'eau
attachés à cette société sont vetus d'une
veste et d'une culotte bleues garnies de boutons jaunes, et sur leur bonnet
une plaque de cuivre gravée aux armes du Roi et de la Ville. Les
seaux sont marqués de 4 clous en dedans pour marquer la mesure
de 36 pintes des porteurs d'eau.
Les fontaines publiques débitaient difficilement 2 litres par
jour pour chaque habitant mais 30 000 puits fournissaient une eau glauque,
insalubre pourtant préférée des Parisiens.
Sommelier
Un sommelier est une personne ayant des compétences en dégustation du vin et autres boissons,
un savoir-faire sur leur service et présentation, et des connaissances sur les divers accords avec les plats conseillant les
clients des restaurants.
En savoir plus sur le métier de sommelier
Tonnelier
Le tonnelier est un artisan qui confectionne des tonneaux (fûts en bois).
Le tonneau est inventé par les Celtes ou les Gaulois.
Il servit d'abord à stocker des produits solides comme les grains, les salaisons ou même les clous, mais également des liquides.
D'abord appelé charpentier de tonneau, les maîtres tonneliers « tonloiers » ou « barilliers » étaient déjà réunis en corporation au IXème siècle.
Le tonnelier a pris l'appellation qu'on lui connait au XIIIème siècle.
En 1444, Charles VII de France confirma les statuts des tonneliers ou barilliers
(les tonneliers charpentiers ou foudriers ont pour leur part été rattachés
à la corporation des charpentiers dès le Xème siècle).
Au moyen-âge, les rois avaient leur propres tonneliers, chargés d'entretenir les barils et les muids.
La fédération française de la tonnellerie est créée en 1978.
Verrier
L’histoire du verre remonte à la Préhistoire : en 100 000 av. J.-C., l'obsidienne, un verre volcanique naturel,
est déjà taillée par l'homme pour former des pointes de flèches.
À la fin du vie siècle av. J.-C., la technique du verre sur noyau se développe en Méditerranée orientale.
L'application de fils de verre façonnés en zigzag ou en guirlande sur un corps en argile,
permet de décorer des contenants à huile parfumée ou à vin, telle l'œnochoé.
L’invention de la canne à souffler le verre est survenue au Ier siècle av. J.-C.
On attribue l'invention de la technique de soufflage du verre aux Phéniciens ou aux Babyloniens grâce à l’invention de la canne à souffler
qui permet de fabriquer des objets en verre plus facilement, plus rapidement et donc à moindre coût,
ce qui démocratise l'usage du verre pour les récipients.
Vigneron
Viticulteur ou vigneron est le métier des personnes qui cultivent la vigne pour produire du vin ou du raisin.